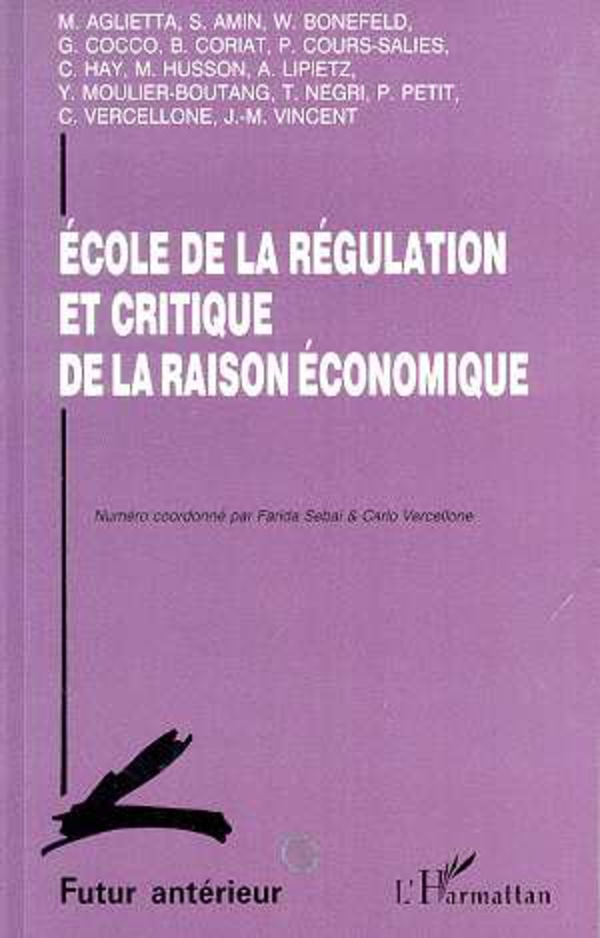

Il y a quatre ans à peine, lors de l’effondrement des « régimes socialistes réels » d’Europe de l’Est, beaucoup se sont précipités pour décréter le triomphe définitif du capitalisme comme mode d’organisation économique et sociale. Aujourd’hui, on vit toutefois des lendemains qui déchantent : le nouvel ordre mondial promis par George Bush se révèle n’être qu’un nouveau désordre mondial qui frappe durement une grande partie de l’humanité. Certes, le capitalisme n’est pas aux abois et il serait hasardeux de prédire sa disparition prochaine, mais beaucoup de ses laudateurs sont obligés de reconnaître qu’il fonctionne mal et produit beaucoup d’effets négatifs. Le marché n’apparaît plus comme cette panacée qui règle tous les problèmes : l’allocation rationnelle des ressources, le développement, l’éradication de la pauvreté, etc. La crise économique, ce vieux spectre, est de retour alors qu’on le croyait à jamais conjuré. Aussi bien l’idée d’une critique du capitalisme comme critique de son économie politique et de la réalité que cette dernière prétend cerner ne peut-elle être aussi insensée que d’aucuns veulent bien l’aftirmer.
Marx, en ce sens, n’est pas si inactuel, lui qui a le premier conçu une critique de l’économie politique du Capital (critique tant de la théorie que de la réalité). Il est donc tout à fait légitime de se poser la question d’une reprise critique de cette entreprise inachevée en tenant compte de l’eau qui a coulé sous les ponts depuis la fin du dix-neuvième siècle. Il importe en particulier de comprendre ce qu’a signifié la longue période de coexistence conflictuelle du capitalisme avec le « socialisme réel » et comment les deux compétiteurs se sont conditionnés réciproquement pendant près de soixante-dix ans. La critique de l’économie politique aujourd’hui ne peut de fait se passer d’une critique de l’économie politique du « socialisme réel » et de son mode d’insertion dans des rapports internationaux sous la dominance du capitalisme. Pendant des années, on s’est contenté de vues simplificatrices, pour ne pas dire simplistes, sur la planification à l’Est. A gauche, on avait tendance à déplorer ses caractéristiques bureaucratiques et l’on postulait et espérait sa régénération démocratique. A droite, on dénonçait une économie de commandement, complément indispensable du totalitarisme politique et idéologique. On ne se posait pas, en réalité, le problème des rapports sociaux et économiques sous-jacents à la planification et à l’organisation étatique, encore moins celui de la logique d’évolution du système pris dans son ensemble (et dans ses rapports avec le capitalisme).
Les analyses les plus intéressantes, produites la plupart du temps par des hérétiques de gauche, ont montré que le « socialisme réel » représentait bien sûr un défi pour le capitalisme, mais aussi un élément stabilisateur dans la mesure où il l’obligeait à se réformer au moins partiellement et à trouver des réponses aux revendications portées par les luttes ouvrières pour préserver ses arrières. Comme l’a bien montré l’Ecole de la régulation, il n’y a jamais eu de marché capitaliste sans une forme quelconque de régulation, et ce qu’il faut bien voir c’est que les pays du « socialisme réel » ont été, au delà des régulations nationales, des éléments indirects de régulation du capitalisme à l’échelle internationale. De fait, les Etats-Unis ont pu asseoir relativement facilement leur hégémonie sur le monde occidental, parce qu’ils ont pu faire valoir leur protection contre la menace soviétique (à la fois conventionnelle et atomique sur le plan militaire). En d’autres termes, les pays capitalistes les plus forts sur le plan économique, ont accepté le système monétaire international de Bretton Woods et la domination américaine sur les organismes financiers internationaux en partie pour des raisons extra-économiques. Il s’est ainsi produit une régulation internationale qui a favorisé l’accumulation du capital dans certaines zones du monde (Europe occidentale, Japon) et donné un coup de fouet aux échanges économiques internationaux ainsi qu’à l’expansion du marché mondial. Cette régulation, pendant des années, a orienté une grande partie des flux financiers vers l’investissement productif, garantissant par là la prospérité du monde occidental.
Les choses ont commencé à changer quand la suprématie américaine a été battue en brèche sur le plan économique comme sur le plan politique. Le Japon et l’Europe occidentale, dans les années soixante et soixante-dix, ont obtenu effectivement des taux de croissance sensiblement supérieurs à ceux des Etats-Unis, de plus en plus enlisés dans la guerre du Vietnam. Les excédents commerciaux des Etats-Unis ont fait peu à peu place à des déficits importants de la balance des comptes qui ont miné la confiance dans le dollar. Le système monétaire international, dans ce contexte, n’a pu en conséquence être maintenu. On est allé très vite vers le flottement des monnaies et des mouvements erratiques de capitaux. Dès les années soixante-dix, les Etats-Unis sont en fait devenus des importateurs de capitaux et cela au détriment de l’accumulation dans d’autres parties du monde. Insensiblement la régulation fondée sur l’exportation de capitaux américains vers des régions à régimes d’accumulation dynamiques, s’est transformée en une régulation fondée sur la gestion de dettes américaines croissantes, du recyclage des pétro-dollars à partir des chocs pétroliers, et de plus en plus sur la gestion des dettes rapidement croissantes des pays dits en voie de développement. Une telle régulation, toujours sous hégémonie américaine du Nord, a fait atteindre à l’endettement, et cela à l’échelle internationale, des niveaux vertigineux. Beaucoup de pays du tiers monde se sont enfoncés dans le cercle vicieux de la pauvreté en s’endettant encore en plus pour payer les intérêts des dettes anciennes tout en vendant leurs matières premières et leurs monoproductions à bas prix (concurrence des pays pauvres entre eux). La régulation est devenue peu à peu chaotique dans la mesure où la flambée des taux d’intérêt a défavorisé l’investissement productif en poussant même les entreprises à la spéculation monétaire et financière. Dans ce cadre, l’investissement productif s’est fait lui aussi de plus en plus spéculatif, on a commencé, en jouant sur la flexibilité des technologies nouvelles, à délocaliser très rapidement les activités productives pour chercher des profits élevés.
On est arrivé ainsi à une situation de dérégulation, où les capitaux flottants (vraisemblablement plus de 900 milliards de dollars) largement déconnectés des capitaux productifs ont mondialisé les économies nationales ou régionales dans le désordre. L’Europe de l’Ouest, longtemps havre de prospérité, a été destabilisée à son tour par l’endettement allemand consécutif à l’unification du pays. Il n’y a guère que le Japon à présenter aujourd’hui une apparence relativement stable, parce qu’il a su se protéger contre les vagues de la mondialisation par différentes formes de protectionnisme. Dans ces conditions, on ne peut donc s’étonner que la transition au capitalisme des pays du socialisme réel se révèle particulièrement épineuse sinon bloquée (particulièrement dans l’ex-Union soviétique). Les marchés occidentaux ne s’ouvrent que parcimonieusement aux produits venus de l’Est et les capitaux ne se précipitent pas pour transformer les économies essoufflées du socialisme réel. La marche vers le capitalisme s’accompagne de chômage, d’inflation, de baisse de niveau de vie et du développement de la criminalité organisée (les mafias), sans que l’on puisse prédire la fin du tunnel.
Certes, dans le désordre actuel, tout élément de régulation n’a pas disparu. Il y a le directoire des sept grandes puissances économiques et le poids des Etats-Unis dans les grandes banques internationales, mais les mesures qui peuvent être prises n’ont en général pas de cohérence ou bien sont insuffisantes pour avoir véritablement de l’effet. L’impérialisme américain reste bien le premier impérialisme, mais il n’a plus assez de force pour discipliner ses partenaires ou pour imposer des orientations sur le moyen et le long termes. Et il y a fort peu de chances pour que le Japon et la communauté européenne secouée par des tendances centrifuges puissent se substituer aux Etats-Unis dans le rôle d’impérialisme dominant dans les années qui viennent. On peut, bien sûr, spéculer sur l’apparition dans plusieurs décennies d’un bloc du Pacifique (Chine, Japon, Taïwan, Corée, etc.) qui pourrait exercer une véritable hégémonie sur l’économie mondiale, mais, pour le moment tout au moins, on peut constater que le degré d’internationalisation des forces productives et des échanges économiques rend improbable, sinon impossible, une régulation internationale à partir d’un Etat-nation (ou d’un groupe d’Etats-nations). En d’autres termes, des politiques financières et économiques nationales ne peuvent plus servir de fondement à une régulation internationale dans le contexte présent de l’économie mondiale.
On peut donc affirmer qu’il ne peut y avoir de véritable régulation internationale sans une concertation très poussée entre les Etats, concertation qui prendrait en charge les problèmes Nord-Sud aussi bien qu’Est/Ouest en contrôlant les flux financiers et en les orientant là où se posent, de façon aiguë des problèmes de développement. C’est dire qu’une régulation internationale efficace suppose un profond bouleversement des rapports entre. les Etats qui substituerait une coopération permanente à l’état de guerre économique larvée ou ouverte – caractéristique de la situation actuelle. Le plus souvent les jeux économiques sont des jeux à somme nulle ou négative (ce que les uns gagnent les autres le perdent). Pour arriver à des jeux économiques à somme positive, il faut, par suite, que les différentes formes de puissance publique n’entretiennent pas elles-mêmes la guerre économique, c’est-à-dire qu’elles cessent de se subordonner à l’accumulation du capital. De nos jours la crise de l’Etat-Providence apporte une démonstration éclatante de la nécessité de ce renversement de tendances. Alors que beaucoup croyaient que l’Etat-Providence avait définitivement introduit des principes non capitalistes dans la vie sociale et économique (protection sociale, production de services pour le public par opposition à la production de marchandises et de valeurs), il est clair maintenant que la logique de l’accumulation capitaliste remet en question des pans entiers de la protection sociale et pousse à la soumission des prestations étatiques à la dynamique de la valorisation (le rapport au public remplacé par des rapports à des clients, apparition de notions de rentabilisation des services publics, etc.). Il est vrai que les tentatives pour diminuer les prélèvements publics n’ont donné que des résultats décevants et que le retour à l’état de choses antérieur (celui du début du siècle) est tout simplement impossible. Mais il ne faut pas oublier que la guerre menée contre l’Etat-Providence pour le reconditionner se fait au prix de coûts humains et sociaux très élevés. On paye très cher la relégation sociale des chômeurs de longue durée dans des stages de formation, dans des situations d’assistés (RMI, etc.). En même temps, le coût de cette relégation sert d’alibi pour s’attaquer à la sécurité sociale, aux systèmes de retraite et à toute une série de politiques publiques. On vit par là dans le domaine de l’absurde ; la dynamique capitaliste appauvrit la société en mettant des millions d’individus hors de la sphère du travail et pour retrouver les voies de la croissance elle l’appauvrit encore plus en diminuant les moyens de la puissance publique et ses capacités.
On voit tout de suite l’objection : la voie du salut serait-elle la subordination de l’économique au bureaucratique ? L’échec de la planification du socialisme réel et la confiscation de la propriété étatique par une classe bureaucratique dominante n’ont-ils pas montré que cette voie était une impasse ? Un premier élément de réponse consiste à faire remarquer que la puissance publique n’a pas besoin d’être étatique-monolithique, mais qu’elle peut être multiple, pluraliste. On peut faire remarquer également que la propriété étatique-monopolistique peut céder la place à des formes diversifiées de propriété sociale ouvrant la possibilité de participations différentielles et flexibles aux biens sociaux. En second lieu on peut répondre qu’il n’est pas nécessaire de planifier les comportements et les actions des unités et des agents économiques, mais qu’il suffit de donner un cadre et des règles à des ajustements spontanés. Il ne s’agit pas de limiter les échanges, mais au contraire de les libérer en les soustrayant aux contraintes de la valorisation. Cela implique évidemment une transformation du salariat et du travail en combinant un système d’allocation universelle et d’allocations différentielles (pour la mobilité, l’inventivité, la pénibilité, etc.). Cela implique également une transformation des systèmes de formation pour diffusion maximale des connaissances dans un contexte de lutte contre l’échec scolaire et pour la formation continue. Dans ce domaine comme dans d’autres, flexibilité, souplesse de réaction peuvent s’allier en permanence avec des concertations systématiques à tous les niveaux.
Il s’agit progressivement de donner d’autres assises aux activités de production et à l’économie en substituant à la valorisation des capitaux l’utilisation concertée et multiforme des moyens dont dispose la société pour permettre à l’immense majorité sinon à tous de participer à des relations sociales, et interindividuelles riches et changeantes. Il n’y a pas à se laisser enfermer dans le dilemme plan ou marché ou encore dans l’affirmation d’une complémentarité plan et marché qui peut receler la collaboration du capital et de la bureaucratie. On ne proposera naturellement pas la fin de tout recours à la monnaie ou encore la fin de tout calcul d’efficacité dans l’emploi des moyens, mais bien une rupture avec la monétarisation-valorisation de toutes les relations sociales. Il faut le dire ouvertement, le marché (ou les marchés) tel qu’il se développe aujourd’hui n’apportera aucune solution aux maux de la société. Le marché mondial est une arène où s’affrontent les stratégies des grandes firmes transnationales et du capital financier, c’est aussi un ensemble hiérarchisé et instable où les capitaux les mieux organisés pénètrent et déstabilisent des marchés secondaires (régionaux ou nationaux) éclatés et poreux. C’est aussi un marché du travail qui détruit sans cesse des vies humaines à l’échelle de la planète, parce qu’il précipite la force de travail dans des formes meurtrières de concurrence. Il ne véhicule plus l’autonomie de l’entrepreneur individuel des débuts du capitalisme, il véhicule en fait de plus en plus d’hétéronomie et d’impuissance face aux problèmes les plus menaçants (catastrophes écologiques, dualisation des sociétés).
C’est bien pourquoi il faut renouer avec une idée fondamentale de Marx : la critique de l’économie politique doit se faire pratique politico-sociale. D’une certaine façon, il y a eu une économie politique de la classe ouvrière à travers l’action des syndicats et des partis ouvriers, mais elle s’est laissé enfermer dans les limites du salariat et de la valorisation du travail abstrait. Il importe dorénavant de sortir de ces limites et de changer le rapport salarial dans et par l’action collective. La crise de l’Etat-Providence qui est aussi crise de la représentation politique et crise des grandes organisations bureaucratisées attachées à l’aménagement du rapport salarial (à la vente à bon prix de la force de travail notamment) peut être l’occasion de bousculer les stratégies anciennes et d’ouvrir de nouvelles perspectives.